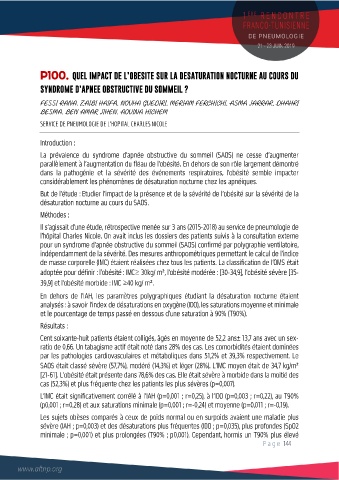Page 145 - Livre électronique des Rencontres Franco-Tunisiennes de Pneumologie 2019
P. 145
P100. QUEL IMPACT DE L’OBESITE SUR LA DESATURATION NOCTURNE AU COURS DU
SYNDROME D’APNEE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL ?
FESSI RANA, ZAIBI HAIFA, NOUHA GUEDIRI, MERIAM FERCHICHI, ASMA JARRAR, DHAHRI
BESMA, BEN AMAR JIHEN, AOUINA HICHEM
SERVICE DE PNEUMOLOGIE DE L’HOPITAL CHARLES NICOLE
Introduction :
La prévalence du syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) ne cesse d’augmenter
parallèlement à l’augmentation du fléau de l’obésité. En dehors de son rôle largement démontré
dans la pathogénie et la sévérité des événements respiratoires, l’obésité semble impacter
considérablement les phénomènes de désaturation nocturne chez les apnéiques.
But de l’étude : Etudier l’impact de la présence et de la sévérité de l’obésité sur la sévérité de la
désaturation nocturne au cours du SAOS.
Méthodes :
Il s’agissait d’une étude, rétrospective menée sur 3 ans (2015-2018) au service de pneumologie de
l’hôpital Charles Nicole. On avait inclus les dossiers des patients suivis à la consultation externe
pour un syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) confirmé par polygraphie ventilatoire,
indépendamment de la sévérité. Des mesures anthropométriques permettant le calcul de l’indice
de masse corporelle (IMC) étaient réalisées chez tous les patients. La classification de l’OMS était
adoptée pour définir : l’obésité : IMC≥ 30kg/ m², l’obésité modérée : [30-34,9], l’obésité sévère [35-
39,9] et l’obésité morbide : IMC ≥40 kg/ m².
En dehors de l’IAH, les paramètres polygraphiques étudiant la désaturation nocturne étaient
analysés : à savoir l’index de désaturations en oxygène (IDO), les saturations moyenne et minimale
et le pourcentage de temps passé en dessous d’une saturation à 90% (T90%).
Résultats :
Cent soixante-huit patients étaient colligés, âgés en moyenne de 52,2 ans± 13,7 ans avec un sex-
ratio de 0,66. Un tabagisme actif était noté dans 28% des cas. Les comorbidités étaient dominées
par les pathologies cardiovasculaires et métaboliques dans 51,2% et 39,3% respectivement. Le
SAOS était classé sévère (57,7%), modéré (14,3%) et léger (28%). L’IMC moyen était de 34,7 kg/m²
[21-61]. L’obésité était présente dans 78,6% des cas. Elle était sévère à morbide dans la moitié des
cas (52,3%) et plus fréquente chez les patients les plus sévères (p=0,007).
L’IMC était significativement corrélé à l’IAH (p=0,001 ; r=0,25), à l’IDO (p=0,003 ; r=0,22), au T90%
(p0,001 ; r=0,28) et aux saturations minimale (p=0,001 ; r=-0,24) et moyenne (p=0,011 ; r=-0,19).
Les sujets obèses comparés à ceux de poids normal ou en surpoids avaient une maladie plus
sévère (IAH ; p=0,003) et des désaturations plus fréquentes (IDO ; p=0,035), plus profondes (SpO2
minimale ; p=0,001) et plus prolongées (T90% ; p0,001). Cependant, hormis un T90% plus élevé
Pag e 144